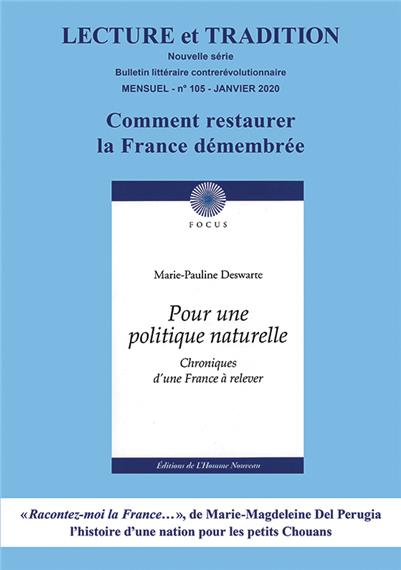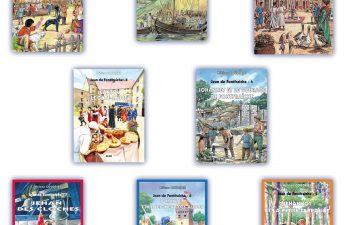Pour une politique naturelle. Chroniques d’une France à relever, par Marie-Pauline Deswarte (Éditions de l’Homme Nouveau, 2019).
Voilà un titre qui nous parle, tant il évoque pour nous d’anciennes et mémorables lectures, un titre qui se rattache aux piliers les plus solides de la pensée contre-révolutionnaire. Dans ce petit livre, clair et dense, Marie-Pauline Deswarte porte un regard incisif et profond avec toute la maîtrise et le talent didactique de l’universitaire juriste [1] sur cette notion majeure de notre patrimoine politique et pose la question : quel principe fondamental opposer au déclin français, à cette lente et inexorable déchéance du politique qui sévit en France depuis plus de deux siècles ? Comment répondre à la question du psalmiste que M.-P. Deswarte a placée en exergue de son ouvrage : « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? »
Car le sujet de sa réflexion est bien la France, non la République qui n’est que la forme actuelle du gouvernement ; cette France qui fut longtemps, selon la belle formule de Jean de Viguerie « cet être moral doté de vertus », aujourd’hui écrasée par le poids de l’idéologie jushumaniste, cette théologie des droits de l’homme léguée par la Révolution. Relever la France, lui redonner son vrai visage, revivifier ses vertus historiques, retrouver les fondations de son identité politique, sociale, civilisatrice, telle est la tâche à laquelle M.-P. Deswarte s’est attelée et, disons-le d’emblée, avec un bonheur qui, durant la lecture des cent quinze pages de son petit livre, n’a jamais faibli. Retrouver le contenu et le sens de cette politique naturelle dont, il est vrai, Charles Maurras, dans un de ses livres les plus célèbres, a posé magistralement les principes fondamentaux, c’est d’abord comprendre comment la France les a perdus.
La France dénaturée
La dénaturation de la société procède de trois ambitions qui ne furent que de désastreuses illusions.
La première fut celle de la régénération humaine. On sait, comme l’ont montré les travaux de Xavier Martin, que cette régénération ne fut qu’une illusion ; l’homme de la Révolution, enfant des Lumières, est un être profondément dégradé. Le moule anthropologique du Code civil, conçu comme l’instrument de rénovation du corps social, n’engendra qu’une toute petite chose, faible, mécaniste, sensualiste, pessimiste, passive et matérialiste. Un être déchu.
La deuxième illusion fut celle de l’autorité, ruinée par le chaos révolutionnaire, dégénérant en terreur systémique, à laquelle succéda l’anarchie directoriale puis la dictature consulaire et impériale. Cette dernière, un temps, donna le change, mais son autorité était fragile parce que non enracinée. L’Empire pouvait bien se prévaloir de la légitimité révolutionnaire, celle-ci ne pouvait remplacer la légitimité monarchique. Napoléon, selon le mot de M.-P. Deswarte, « tenta la greffe », mais elle ne prit pas, tant pesait sur l’Empire ce que Maurras appelait la « fatalité des origines » qu’aggravait l’absence des vrais principes d’organisation sociale qui avaient fait leurs preuves sous l’Ancien Régime. La Révolution les avait rejetés ou dénaturés ; et Napoléon, même investi par une Église certes revigorée, mais enserrée dans les rets du concordat, n’a jamais pu vraiment les restaurer.
La troisième illusion fut celle de la fraternité qui devait cimenter la liberté et l’égalité, les deux conquêtes majeures de la Révolution aux effets dévastateurs sur les liens sociaux naturels qui existaient auparavant : famille détruite par le divorce, professions affaiblies par la suppression des corporations, congrégations religieuses anéanties, provinces et communes asservies. À la vertu chrétienne de charité, la Révolution a substitué la fraternité, « vertu » factice, caricature de la charité chrétienne. À la charité conçue comme « l’union des cœurs dans l’amour de Dieu » (S. Pie X) est substituée la fraternité regardée comme l’union des cœurs dans l’amour de la patrie révolutionnaire, une fraternité fondée sur l’agglomération d’individus, et dans l’impossibilité de rétablir le lien social détruit par la Révolution.
La France démembrée
La rupture est donc radicale. Avec la France d’Ancien Régime disparaît ce qu’on peut appeler une France charnelle, « organique », une patrie chargée de réalités spirituelles, sociales, économiques, territoriales, la France des provinces, des communes libres, des libertés professionnelles, défigurée par des découpages territoriaux abstraits, sans âme, imposés par l’obsession unitaire de l’idéologie républicaine. M.-P. Deswarte rappelle que les départements n’avaient que de simples compétences administratives et leurs représentants élus étaient désignés pour gérer les affaires nationales : les libertés locales avaient disparu. La centralisation administrative est la condition impérative de l’indivisibilité de la République. C’est pour elle une question de survie. Il y a bien eu quelques efforts de libéralisation du territoire et l’amorce d’une décentralisation, notamment avec la IIIe République, les lois de 1871 et 1884 pour les départements et les communes, mais ce desserrement n’est pas décentralisateur par principe, mais par nécessité tactique et conjoncturelle. M.-P. Deswarte souligne très justement qu’elle a été surtout un moyen pour la République encore fragile, d’établir plus solidement son assise territoriale. Tel était l’objectif de Gambetta, qui défendit l’institution sénatoriale comme l’instrument de la conquête républicaine des villes et des villages. Il est vrai que, par la suite, les IVe et Ve Républiques, considérant sans doute que le régime est suffisamment consolidé, ont fini par reconnaître l’existence de collectivités décentralisées, admettant ainsi que, quoiqu’indivisible, « l’assise territoriale n’était pas le tout de la République ». En réalité cette décentralisation, très encadrée et assortie de procédures démocratiques, est encore un « moyen de servir à l’expansion de l’idée républicaine ».
Il n’est pas jusqu’à la nation qui n’ait accompagné la dissolution de la France « organique ». Initialement conçue comme le plus vaste des cercles communautaires qui soient, solides et complets, à la fois réalité politique et culturelle, la nation est le produit d’une lente sédimentation de toutes les richesses communes, de l’identité morale et spirituelle et qui, par la succession des générations, constituent un peuple doté de la conscience qu’il a été et qu’il continuera d’être ce qu’ont été les générations qui l’ont précédé. C’est cet être charnel que la Révolution a détruit puisqu’elle n’est plus un passé ; elle n’est qu’un perpétuel devenir, contractualisé mais désincarné, impuissant à établir et à maintenir un lien social. La nation au sens de Bossuet était à même de fédérer une multitude de réalités, de peuples autour d’une histoire, d’un héritage commun. Corsetée par la puissance idéologique qui lui est sous-jacente, la nation révolutionnaire ne peut fédérer que des individualités abstraites.
Il y a donc deux républiques : d’une part, une république – comme celle de Bodin [2] – conçue comme le cadre d’un gouvernement qui ne prévaut pas sur la nation ou la patrie, qui préserve la communauté forgée autour de la nation ; d’autre part, la République qui se veut totalité, système politique et cadre spirituel. L’instauration de cette République a détruit la première.
Jean-Baptiste GEFFROY
Lire la suite de cet article dans notre numéro
[1] – Marie-Pauline Deswarte est professeur émérite de droit public de l’Université d’Artois.
[2] – Pour Jean Bodin (1530-1596), la République – c’est-à-dire la chose publique juridiquement organisée – est premièrement, « le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ». Ne peut donc être regardée comme République une communauté qui ne serait pas gouvernée « droictement » c’est-à-dire conformément à la morale. Deuxièmement, cette République est composée de familles (ménages), cellules politiques par excellence et non d’une agglomération d’individus, et qui constituent une base communautaire, un intérêt collectif. Troisièmement, cette République ainsi constituée se parachève en puissance souveraine, c’est-à-dire absolue et perpétuelle.